Colloque sur la responsabilité des gestionnaires publics : table ronde “Regards croisés”
Acteurs publics publie l’intégralité de la table ronde “Regards croisés sur la responsabilité des gestionnaires publics” qui s’est déroulée le 18 octobre 2019 à l’occasion du colloque coorganisé par la Cour des comptes et le Conseil d’État.


Modérateur :
Jean Gaeremynck, président de la section des finances du Conseil d’État
Intervenants :
Isabelle Falque-Pierrotin, conseillère d’État, ancienne membre du collège des garants du grand débat national
Marie-Anne Levêque, secrétaire générale des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Fabienne Keller, députée européenne, ancienne maire de Strasbourg
Thomas Cazenave, délégué interministériel à la transformation publique (jusqu’au 16 novembre 2019)
Raoul Briet, président de chambre maintenu à la Cour des comptes
 Jean GAEREMYNCK
Jean GAEREMYNCK
Nous avons hérité d’un système de responsabilité des gestionnaires publics. Nous l’avons vu fonctionner, évoluer, et il nous faut dire quelque chose ce matin de ses forces, ses faiblesses. Les personnalités qui composent cette table ronde sont particulièrement bien placées pour cela du fait de leur expérience, de leur diversité et de leur complémentarité. Je vais leur donner la parole dans un instant.
Quelques brèves remarques pour introduire leurs propos : je ne crois pas m’aventurer en énonçant que le système est soumis aujourd’hui à des fortes tensions, voire des contradictions. Trois exemples.
Il y a manifestement dans le pays une exigence de résultat de l’action publique. On pointe quelquefois la distance entre le discours et les résultats concrets. Si les résultats se font attendre, c’est que les problèmes à résoudre sont difficiles. C’est la réalité qui, souvent, résiste à la transformation sociale. Il ne suffit pas de dire, comme on l’entend quelquefois, qu’il y aurait un État profond qui freinerait des quatre fers à la réalisation des réformes nécessaires au pays. On ne s’en tirera pas par du pur volontarisme. On a besoin d’imaginer des solutions nouvelles, d’innover, d’expérimenter, en un mot, de prendre des risques. Mais en même temps, il y a une hypersensibilité de nos concitoyens – cela a été dit, je pense que nous y reviendrons – à la dépense publique, à sa régularité bien sûr, mais aussi à son efficacité, à son impact. On ne supporte pas le laxisme et il faut que toute dépense soit directement utile. Est-ce qu’on n’a pas là une première source de contradiction ?
Deuxièmement, comme nous sommes en France, la règle de droit est partout. Notre système de responsabilité est largement construit autour du contrôle, du respect de la règle. La CDBF [Cour de discipline budgétaire et financière, ndlr], à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir, a pour disposition phare du code des juridictions financières à appliquer, le L.313-4 qui enjoint – on serait étonné du contraire – de respecter pour les gestionnaires les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses.
Mais on sait bien que cela ne suffit pas et qu’il faut apprécier aussi la qualité de la gestion. Là, c’est plus difficile. Les processus de décision sont plus complexes, beaucoup d’intervenants, des chaînes d’intervenants. Et puis quelle méthode pour apprécier la qualité de la gestion ? Là, c’est tout le débat qui s’ouvre sur la performance. Je pense que là aussi, nous y viendrons, notamment à propos des ambitions – et quel bilan aujourd’hui ? – de la Lolf.
Troisième et dernière remarque, nous aimons bien les grands principes. Nous les avons reçus en héritage et nous les affirmons. Dans le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dit « décret GBCP » de novembre 2012, que j’ai quelque raison de connaître, exemple du pilier du système : le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Commode à énoncer, facile à retenir, venant apparemment du fond des âges, on se demande si on n’a pas des traces dans le Code de Hammurabi*. Pourtant, ces principes, et celui-là en particulier, sont sans doute un peu bousculés aujourd’hui par les nouveaux process de décision, les nouvelles technologies, les modes d’organisation et c’est cela qu’il faut interroger.
Je pourrais citer d’autres exemples, mais je ne le fais pas, j’ai trop parlé. Je voudrais maintenant passer la parole aux personnalités présentes. Je commence par Madame Isabelle Falque-Pierrotin, qui est bien connue pour avoir présidé de longues années la Commission nationale informatique et libertés et aussi, dans la période récente, pour avoir fait partie des personnalités garantes du grand débat. À ce titre, je crois que vous êtes idéalement placée, et compte tenu de votre expérience personnelle, pour dire quel sentiment vous avez retiré à propos de ce grand débat sur les attentes et les sentiments profonds de nos concitoyens en la matière.
 Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Merci à la Cour des comptes et au Conseil d’État de nous avoir rassemblés pour ce sujet aussi stimulant.
Effectivement, à la lumière du grand débat et également à la lumière de mon expérience à la Cnil, il m’a été demandé d’éclairer d’une certaine manière les attentes que les uns et les autres ont vis-à-vis des gestionnaires publics. Pour ce qui est du grand débat, au-delà de l’expérience directe de garant – nous étions 5 garants et nous avons participé à toute une série de réunions sur place –, je me suis appuyée sur le travail de la Cour des comptes, il en a été dit un mot, mais également sur les réflexions du Cevipof [Centre de recherches politiques de Sciences Po, ndlr] qui a couvert 250 réunions locales pendant le grand débat. J’ai pu échanger avec Martial Foucault sur les enseignements qu’il tire de ces réunions locales.
Quel est le constat de départ ? Le constat de départ – et pardon de le dire de façon aussi brutale ce matin –, c’est quand même une crise de confiance inédite vis-à-vis de nos gestionnaires publics, d’abord les élus locaux, à l’exclusion des maires, qui sont critiqués, surtout en termes de gaspillage, et même un délit spécifique a été proposé, mais aussi en termes de détournements et d’irrégularités. Critique également – rassurons-nous – des fonctionnaires, des gestionnaires publics de Paris, est-il dit, loin du terrain, qui prennent des décisions sans connaître la réalité. Ce qui est exprimé, c’est un besoin d’accountability, de rendre compte, des gestionnaires publics et, le cas échéant, être sanctionné. D’ailleurs, une sévérité supplémentaire, accrue, est demandée par le grand public.
Les participants ne sont pas nécessairement demandeurs d’actions directes de leur part dans l’évaluation des politiques publiques. Ils veulent néanmoins plus d’informations, plus de pédagogie. D’ailleurs, ce qui nous a frappés au niveau des garants, c’est qu’il y avait un déficit considérable de compréhension des politiques publiques, mais ils se plaignent aussi que ces explications pourraient être trop compliquées et qu’ils n’arriveraient pas à mesurer toutes les dimensions de ces politiques publiques. Il y a donc une forme de contradiction entre tout cela.
Au total, ce qui est exprimé, c’est un problème de lisibilité de l’action des gestionnaires publics et une demande, un besoin d’accountability de ceux‑ci.
Cette situation n’est pas nouvelle. Moi-même, à la Cnil, depuis 2011, j’ai fait face à exactement le même type de défiance a priori. Le régulateur est critiqué par certains comme trop lent, décalé par rapport à des révolutions technologiques complexes, en décalage avec les attentes sociales. Ce qui est également critiqué au niveau du régulateur, et c’est une critique qui est vraie au niveau des gestionnaires publics, c’est la pertinence de ces outils. Est-ce que ces outils de gestionnaires publics sont suffisamment en prise avec la réalité complexe à laquelle font face les individus ?
La question que l’on peut se poser est : comment en sommes-nous arrivés là ? Nous en parlions lorsque nous préparions cette table ronde et nous nous disions mutuellement : dans les années 1990, la France, son administration et ses gestionnaires étaient considérés de façon quasi unanime comme un des meilleurs du monde. Pourquoi, aujourd’hui, y a-t-il une telle crise de confiance par rapport à ces gestionnaires publics ? Il y a probablement toute une série de raisons. Je voudrais juste en pointer trois à l’aune de l’expérience du grand débat et de la Cnil.
Premièrement, l’impact du numérique. C’est sûr, le numérique donne aux individus une puissance considérable. Ils sont moins dociles, ils peuvent aisément contourner la décision publique et exprimer leur mécontentement. Ils se mettent également au code des consommateurs on line, c’est-à-dire plus d’exigence, plus de rapidité. Il faut que le gestionnaire public soit en capacité de délivrer une prestation, un service, tout, tout de suite. Deuxièmement, des politiques publiques qui ont été plus changeantes au fil du temps. Moins de continuité de ce que ces gestionnaires publics défendent, donc, plus difficilement identifiés comme au service de l’intérêt général. Enfin, troisième raison peut-être, la question de ce que les Anglo-saxons appellent la legacy, c’est-à-dire l’héritage, les couches antérieures de décision, qui ne sont pas nécessairement simplifiées et qui donnent à ceux qui font face aux gestionnaires publics une impression de complexité et probablement une difficulté supplémentaire de lisibilité.
Effectivement, je crois que nous ne pouvons, les uns et les autres, que constater et être convaincus que cette situation est éminemment délétère. Elle nécessite – la deuxième table ronde s’y emploiera, je crois – de dégager de l’innovation, des nouvelles pistes pour cette innovation et auprès de ces gestionnaires publics. Je voudrais juste, non pas indiquer des pistes, mais plutôt indiquer quelques conditions à remplir pour recrédibiliser d’une certaine manière ces gestionnaires publics.
Première piste, la pédagogie de l’action publique. C’est, je l’ai dit, une question majeure de compréhension de la part de nos concitoyens. Mais là, il faut, me semble-t-il, distinguer entre expliquer et communiquer. C’est quelque chose qui est revenu à maintes reprises dans le grand débat. Il nous a été dit : « On communique, mais on ne nous explique rien. » Expliquer, argumenter, donner de la lisibilité à l’action publique, c’est partir des questions que les gens se posent eux-mêmes, ce n’est pas communiquer une politique publique toute ficelée.
Deuxième axe, travailler sur la responsabilisation accrue des gestionnaires publics, mais, me semble-t-il, comme un projet collectif, et pas simplement comme une responsabilisation sanction. Responsabilité collective vis-à-vis de l’intérieur, c’est-à-dire vis-à-vis de l’organisation à la tête de laquelle se trouve le gestionnaire, mais responsabilisation également vis-à-vis de l’extérieur, c’est-à-dire vis-à-vis des publics auxquels le gestionnaire va s’intéresser.
Enfin, troisième axe, la nécessité aujourd’hui de coconstruire la décision publique avec les parties prenantes intéressées. Ceci répondrait à l’objectif de légitimité et d’efficience qui est demandé par nos concitoyens. C’est une conviction que j’ai depuis extrêmement longtemps, qui est qu’aujourd’hui, face à la complexité des décisions qui doivent être prises par les gestionnaires publics, ceux-ci ne peuvent la prendre tout seuls. Ils doivent pouvoir être sur le terrain, proches des acteurs, et agréger tous les inputs, toutes les contributions de ces acteurs. À la Cnil, c’est quelque chose que nous avons fait couramment, coconstruire nos décisions, coconstruire nos outils avec l’aide des parties prenantes.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, très rapidement ce que je pouvais dire en introduction sur cette responsabilité des gestionnaires publics. Vous voyez que c’est une question qui n’est pas simplement une question juridique ou technique, c’est en fait une question de projet politique de ces gestionnaires publics.
Jean GAEREMYNCK
Je donne la parole à Raoul Briet, en rappelant très brièvement qu’il était il y a encore quelques semaines président de chambre à la Cour des comptes et qu’il a auparavant exercé des responsabilités importantes et variées, mais notamment dans les administrations sociales. Fort de cette expérience, que pouvez-vous dire des forces et faiblesses de notre système de responsabilité des gestionnaires publics ?
 Raoul BRIET
Raoul BRIET
Je vais essayer de me limiter à la période la plus récente de ma carrière, c’est-à-dire les enseignements de cette année de présidence de la première chambre de la Cour des comptes, en essayant d’éclairer l’état des lieux demandé par deux angles. Un premier angle assez général, qui portera sur la responsabilité managériale. La Lolf aura bientôt vingt ans. Promouvoir les responsabilités managériales était une des grandes ambitions de la Lolf. Quel jugement peut-on porter aujourd’hui sur la mise en œuvre et la réalité de cette ambition ? Deuxième éclairage de nature complètement différente, beaucoup plus « micro », si vous me permettez l’expression, j’essaierai d’illustrer un cas pratique, malheureusement pas exceptionnel, d’un sinistre majeur dans la gestion publique sans responsabilité et sans responsable désigné : c’est le cas de la mise en place de l’Opérateur national de la paye, qui a coûté en pure perte 340 millions d’euros aux contribuables.
Sur le premier volet, Lolf et responsabilisation des gestionnaires publics, vous connaissez tous les objectifs qui étaient assignés à la Lolf, le changement de culture qui était recherché, passer d’une logique de moyens à une logique de résultats, des objectifs accompagnés d’indicateurs. On a vu apparaître la notion de responsable de programme, notion reconnue tardivement dans les textes avec le décret GBCP de 2012.
Quel bilan peut-on dresser ? Sachant que sur ce sujet, comme assez souvent d’ailleurs, la France a démarré un peu plus tard que beaucoup de pays industrialisés qui avaient fait cette réforme dans les années 1990, mais à sa manière, elle l’a fait de façon très complète, trop complète peut-être, très exhaustive et très outillée, au point que l’OCDE considère que nous avons le dispositif qui, facialement, est parmi les mieux outillés et est exemplaire en termes de gestion budgétaire responsable. Cela, c’est la façade.
Il y a eu bien sûr des progrès, il y a des acquis. Personne n’envisage de revenir au système antérieur. Il n’en reste pas moins que le bilan que l’on peut dresser – on l’a fait dans le dernier rapport sur le budget de l’État en mai 2019 – est un bilan décevant. L’information sur les objectifs et les indicateurs est surabondante et en même temps, elle est peu connue du public. Elle est peu utilisée par les décideurs, particulièrement ceux auxquels elle s’adresse, les parlementaires. Les administrations ont juxtaposé le dispositif Lolf à leur propre dispositif de pilotage interne d’objectifs et d’indicateurs. On a trop souvent confondu l’objectif politique, dont les ministres sont normalement comptables, et l’objectif gestionnaire, dont les directeurs et leurs collaborateurs doivent être responsables. Et puis, peut-être aussi et surtout les marges de manœuvre des responsables de programme ne se sont guère élargies. Il y a une notion avec un terme barbare, la fongibilité asymétrique, c’est-à-dire la possibilité de réutiliser des économies faites sur les dépenses autres que les dépenses de personnel pour abonder d’autres dépenses de fonctionnement. Cette fongibilité asymétrique est restée un cas d’école, donc n’est absolument pas entrée dans la vraie vie. En matière de ressources humaines, le système est resté cadenassé, peu déconcentré. Jusqu’en 2020, il y a encore 562 résidences d’affectation nationale applicables aux agents de la DGFIP, tant et si bien que la mutation d’un arrondissement de l’Ain à un autre arrondissement de l’Ain passe par une CAP nationale. Il paraît que cela va bouger en 2020, mais voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Celui qu’on voudrait désigner comme responsable, un directeur régional des finances publiques, ne peut choisir qu’au maximum 10 % des cadres A qui l’accompagnent. Je ne parle même pas de l’ensemble de ses agents. Ses marges de choix sont, en pratique, très réduites.
Dernier élément en termes de marges de manœuvre, l’horizon temporel de gestion. Quiconque s’est frotté à la gestion publique et à la gestion tout court sait qu’il faut du temps, et que pour apprécier les résultats, il faut un horizon de gestion qui soit au minimum de trois à cinq ans. Or ce que l’on a constaté dans la période récente, en particulier sous l’effet de la crise des finances publiques qui s’est jointe à la crise économique tout court des années 2007-2008, c’est que l’horizon temporel des gestionnaires s’est raccourci. Ce n’est même pas l’année de la loi de finances, c’est devenu, au rythme de trois gels ou surgels annuels, un horizon trimestriel ou semestriel. Illustration de ce rétrécissement des horizons qui n’est pas propre à faciliter une gestion responsable : les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ou conventions de gestion, qui existaient au début des années 2000, ont très largement disparu dans la période récente.
Depuis deux ans, il y a des tentatives de revenir dans une meilleure direction. L’appareillage objectifs-indicateurs a tendu à s’alléger. Bercy a inventé une très belle expression que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer, la notion de « resincérisation » des lois de finances. La « resincérisation », c’est essayer de faire des prévisions sincères. Cela progresse. Il nous reste à espérer que cela progressera jusqu’à la fin de la législature parce qu’on sait que la sincérité varie avec le cycle politique. Mais cela avance un peu. Les conventions pluriannuelles de gestion commencent, à pas très comptés, à réapparaître dans le paysage administratif. Je pense que Monsieur Cazenave reviendra longuement sur ces sujets, il y a des démarches engagées pour alléger certains contrôles. Mon sentiment est que beaucoup de chemin reste à parcourir. Plus fondamentalement, je pense qu’on ne peut pas réfléchir aux questions de responsabilité des gestionnaires uniquement en s’intéressant à l’aval, c’est-à-dire à la fin du processus. Il y a des écosystèmes politiques, administratifs et budgétaires plus ou moins propices au développement des responsabilités et donc, in fine, à la sanction éventuelle des gestionnaires. Il est illusoire de penser développer la responsabilité devant le juge d’un gestionnaire si les conditions ou l’écosystème administratif ne lui permettent en aucune manière de prendre ces risques et d’utiliser les marges de manœuvre qui sont les siennes.
Conclusion provisoire : l’écosystème que la loi ambitionnait de créer reste encore assez largement à construire. En même temps, il ne faut pas oublier qu’une Lolf est une loi organique relative aux lois de finances et que bien d’autres choses créent cet écosystème, qui ne sont pas dans les lois de finances, et qui ne sont pas toutes dans les textes, mais qui sont aussi dans les usages, dans les pratiques administratives, dans les pratiques des directions. Cet écosystème n’est donc pas qu’un écosystème juridique, je pense que c’est tout à fait important de le signaler.
Deuxième point, que je serai plus rapide à commenter ou à livrer à la réflexion des participants, l’exemple d’un échec symbolique très coûteux : l’Opérateur national de paye (ONP). Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique. L’idée sympathique au plan des principes de ce programme lancé en 2007 était d’établir automatiquement la rémunération des 2,7 millions d’agents publics, avec un calculateur de paye, qui était la partie aval, moderne, qui faisait le travail, et en amont, le raccordement des systèmes d’information RH de l’ensemble des ministères à ce moteur et à ce calculateur de paye. Le projet a mal grandi, mal vécu et, en 2014, il a été finalement décidé de renoncer purement et simplement à la mise en œuvre de ce projet, à un moment d’ailleurs un peu délicat en ce sens que la partie finale, c’est-à-dire le calculateur de paye, avait fait l’objet d’une recette. Il existait, il était fonctionnel, il marchait. En revanche, on avait, à juste titre, je pense, définitivement désespéré de la capacité à raccorder les systèmes d’information de ressources humaines des différents ministères à cet objet qui, lui, fonctionnait. On a donc dû purement et simplement tirer un trait sur l’investissement qui a été fait. Cela a coûté selon nos estimations de l’ordre de 360 millions d’euros. Les raisons : conception excessivement ambitieuse, gouvernance défaillante. On comprend bien les raisons qui ont pu conduire à l’échec de ce projet, qu’aucun autre pays n’avait mis en œuvre. Nous avons été, comme souvent en France, extraordinairement ambitieux et rationnels pour construire un système qui n’existe nulle part ailleurs, qui n’a été appliqué nulle part ailleurs, et qui surtout, ne pouvait trouver à s’appliquer à un système des rémunérations de la fonction publique qui reste extraordinairement complexe, extraordinairement divers, extraordinairement touffu. Faire rentrer cet ensemble non simplifié dans des systèmes d’information était probablement une ambition déraisonnable.
Après ce constat de mort, ce constat clinique, nous avons essayé de voir s’il y avait matière à sanctionner les responsables de cet échec patent et coûteux. Nous avons bâti un gros dossier de près de 60 pages, destiné à la Cour de discipline budgétaire, en essayant d’argumenter sur les motifs qui pouvaient justifier des sanctions à l’égard des responsables. Nous avons essayé de voir quels étaient les principes de bonne gestion régissant la maîtrise d’ouvrage des grands projets informatiques qui avaient été méconnus. Ce sont des principes de bonne gestion que l’on trouve dans des manuels, dans des recueils, dans la littérature professionnelle, mais qui ne sont pas évidemment du droit dur. Nous avons essayé d’argumenter sur le défaut de surveillance ou le défaut de contrôle de l’activité d’ONP. La CDBF s’est saisie de ce travail, qui a été fait, je crois, de la manière la plus consciencieuse et la plus rigoureuse possible. Une instruction a été ouverte qui a conduit quasi inévitablement à l’absence de suite. J’ai oublié de préciser, et c’est important, que la caractéristique de ce dossier est qu’il n’y avait aucune irrégularité formelle dans les conditions de passation des marchés, dans les conditions d’exécution de la dépense publique. Cet aspect d’irrégularité formelle ne pouvait donc pas être mis en cause dans ce dossier.
C’est donc un échec sans sanction autre qu’une insertion sévère au rapport public annuel de la Cour des comptes et peut-être aussi l’inconfort de l’instruction devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Mais par rapport à la question que peut se poser le public, est-ce qu’on n’a pas un système qui permet de sanctionner ce qui est moins grave, plus formel, mais qui ne permet pas de sanctionner ce qui est le plus substantiel ? Je pense que c’est une question que l’on doit se poser.
Pour terminer sur une note encore peut-être un peu sombre, mais pour relativiser, j’ai eu aussi à m’intéresser à Dexia. Dexia, c’est le secteur concurrentiel même si les finances publiques ont été très significativement concernées par Dexia : plus de 6 milliards à la charge du contribuable français, sans parler de ce que le contribuable belge et les collectivités locales ont dû également consentir. On est dans un univers concurrentiel et l’enseignement que l’on peut tirer de Dexia par-delà des tas d’autres considérations, c’est qu’il n’y a eu aucune sanction, que ce soit en Belgique ou en France, émanant des tribunaux civils, pénaux ou financiers à l’égard des dirigeants de Dexia. C’est typiquement un sinistre collectif majeur qui n’a connu aucun responsable. Il y a eu une petite atténuation de l’indemnité de départ en retraite des cadres dirigeants, mais rassurez-vous, il n’y a eu aucune remise en cause des retraites supplémentaires qui leur avaient été allouées…
Jean GAEREMYNCK
Merci pour ces exemples extrêmement précis et vivants. Nous allons passer maintenant à une collègue qui, elle, n’est pas au terme de sa carrière, mais qui est immergée dans une situation quasiment paroxystique de gestionnaire public puisqu’elle est secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, immense administration. Dans cette position où vous êtes véritablement tous les jours immergée dans l’action, comment ressentez-vous votre statut de responsable ?
 Marie-Anne LEVÊQUE
Marie-Anne LEVÊQUE
Je représente ici le gestionnaire public, le gestionnaire d’État, le fonctionnaire de Paris. Je vais revenir sur deux aspects, des aspects amont d’une certaine manière, de cette responsabilité, d’une part sa dimension managériale et d’autre part quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, c’est-à-dire les outils de prévention des risques de faute de gestion au sens large du terme.
Premier point, je vais revenir sur la question de savoir où on en est aujourd’hui de la responsabilité des gestionnaires d’État – je ne parlerai vraiment que des gestionnaires d’État – du point de vue de leur autonomie d’action. Il me semble que l’on peut essayer de répondre à cette question en confrontant la réalité à 4 conditions qui me semblent, au moins en théorie, être requises pour manager une organisation en vue de la réalisation d’un objectif de politique publique.
Ces 4 conditions sont les suivantes : disposer d’une programmation à peu près cohérente entre les objectifs, les activités et les moyens ; s’inscrire dans une chaîne de responsabilité à peu près lisible ; disposer d’une visibilité suffisante et d’une stabilité minimale pour mobiliser les marges nécessaires à l’exercice effectif de la responsabilité ; une capacité d’action sur ce que j’appellerais les facteurs de production, c’est-à-dire dans la majeure partie des administrations d’État, la norme d’une part, la RH d’autre part.
Où en est-on ? Je laisse de côté le sujet facteur de production. C’est un sujet qui a été largement investi. Des réformes très importantes, je crois, sont à l’œuvre, tant en matière de fonction publique qu’en matière de simplification des normes. On doit en espérer de substantiels assouplissements.
J’en viens donc aux 3 autres conditions. La première, existence d’une programmation cohérente entre les objectifs et les moyens. Raoul Briet l’a évoqué. Je crois que l’on doit constater que c’est une condition qui n’est pas remplie aujourd’hui. Performances, moyens, articulation performances/objectifs assignés aux politiques publiques, je crois objectivement qu’on n’y est pas. Je passe rapidement.
Autre condition, lignes hiérarchiques claires et à peu près lisibles. Sujet très abordé aussi. Selon moi, il existe 3 types d’obstacles qui s’opposent de ce point de vue à l’exercice de la responsabilité, des obstacles politiques, des obstacles réglementaires, des obstacles structurels. Cela renvoie à la question, sur laquelle je ne m’étendrai pas, du rôle respectif des acteurs politiques et des acteurs administratifs. Cela renvoie à la question des contrôles. Cela renvoie surtout, de mon point de vue, à la question des périmètres d’autorité et de compétences, c’est-à-dire à la question du partage des responsabilités administratives au sein de l’État. On est quand même dans une situation un peu contradictoire aujourd’hui, il me semble, en tout cas, je le livre à votre réflexion, puisqu’on fonctionne à l’État dans la logique qui était celle de la Lolf, qui, fondamentalement, est plutôt une logique d’agence, une logique qui structure l’organisation des moyens, l’organisation des responsabilités, celles des responsables de programmes. C’est, selon moi, une logique d’agence. Or, sous la contrainte budgétaire, la numérisation, les nouveaux modes de relation à l’usager, etc., on a construit ou continué à mettre en place un certain nombre de dispositifs, qui sont très bien dans leur esprit, qui promeuvent plus de transversalité, plus d’interministérialité – je ne le critique pas – et plus de mutualisation entre les administrations.
Il me semble qu’aujourd’hui, on est un peu au milieu du gué et qu’il faut s’interroger sur le modèle d’organisation administrative que l’on souhaite promouvoir, agence, interministérialité, mutualisation, parce qu’aujourd’hui, on est dans une situation où on connaît quand même une forme de juxtaposition, voire superposition de ces deux logiques qui contribue à une dilution et à une complexification, excessive sans doute, des chaînes de responsabilités. Je le livre à la réflexion, je n’ai pas forcément de réponse.
La troisième condition est celle de la visibilité et de la stabilité nécessaire pour l’exercice d’une responsabilité managériale, c’est-à-dire pour être en mesure de procéder aux choix de gestion les plus pertinents. Je livre deux éléments. Il me semble qu’une des faiblesses, qui était bien identifiée d’ailleurs dès 2001 au moment de la conception de la Lolf, est l’absence de toute dimension pluriannuelle dans la mobilisation des moyens. Il y a eu des avancées assez significatives, notamment avec la loi organique de 2012, mais on reste uniquement sur la problématique de la soutenabilité des finances publiques et la pluriannualité n’a aujourd’hui acquis aucune dimension concrète dans le cadre d’action des gestionnaires. Or, il faut le dire assez clairement, la réponse n’est pas forcément simple, cela reste quand même un obstacle absolument majeur pour le pilotage efficace de l’action publique et l’exercice de cette fameuse responsabilité des gestionnaires. Je pourrais donner des exemples, mais je crois qu’aucune organisation privée ne saurait fonctionner ainsi. Des démarches intéressantes sont en cours, qui ont été évoquées par Raoul Briet. Nous allons les suivre avec une grande attention. Je pense tout de même que c’est un problème auquel on n’a pas encore de solution très simple.
Deuxième élément que je livre à la réflexion, de façon un peu provocatrice, au titre de ce besoin de visibilité et de stabilité, c’est quand même la question de la situation « personnelle » des directeurs d’administrations centrales et assimilées. Curieusement, c’est une question qui est assez peu évoquée quand on s’intéresse à la question de la responsabilité des gestionnaires publics, mais elle est assez déterminante pour l’exercice plein et serein de la responsabilité. Je pense que l’on devrait commencer à s’interroger sur les réponses qui pourraient y être apportées en préservant évidemment le caractère discrétionnairement révocable de ces fonctions, le lien de confiance indispensable avec l’autorité politique, mais au moment où on souhaite notamment attirer de nouveaux talents sur ces fonctions, je pense qu’il faut quand même regarder de près cette question.
C’est un constat un peu caricatural, mais on voit qu’il découle de ce que je viens d’essayer de présenter très rapidement, une forme de dilution des responsabilités, d’aversion au risque qui a été très bien décrite dans l’étude de 2018 du Conseil d’État. De ce point de vue, il ne me semblait pas inutile de revenir très rapidement sur l’état des lieux que l’on peut faire aujourd’hui sur les mécanismes de prévention des fautes de gestion. Plusieurs mécanismes ont été mis en place depuis le début de la décennie pour sécuriser l’action des gestionnaires publics. J’en citerai 3.
Premier élément, la démarche de maîtrise des risques et d’audit interne. Elle existe dans tous les ministères, et elle vise à assurer la maîtrise des risques budgétaires, comptables, financiers, mais également les risques liés au pilotage des politiques publiques elles-mêmes. On fait des cartographies des risques, on diligente des audits et on en tire des plans d’action, le cas échéant correctifs. C’est une démarche un peu ingrate, il faut le dire, qui porte progressivement ses fruits en matière budgétaire et financière stricto sensu. Elle est assez largement perfectible quand elle s’intéresse au contrôle des risques liés à la mise en œuvre des politiques publiques, c’est-à-dire au fond à la prévention des choix de gestion erronés. Je donne un exemple parce que cela m’avait un peu interrogée quand j’avais pris mes fonctions. On peut se demander quelle est la capacité effective de ce type de dispositif à prévenir, je cite, « le risque d’inefficacité économique et sociétale des activités de recherche publiques ou le risque de perte de confiance de la société dans les valeurs républicaines de l’école. » Cela laisse un tout petit peu perplexe. Pour être positive, je dirais quand même que cette démarche, lorsqu’elle s’applique à des segments d’activité concrets, quand elle est déployée au plus près de l’action des services opérateurs, peut fournir un appui précieux à condition d’être un peu détechnocratisée, si vous me passez l’expression, pour emporter l’adhésion des acteurs.
Deuxième élément de maîtrise, la structuration des chaînes d’alerte et de crise. Ce sont des choses qui sont très substantiellement professionnalisées. Elles portent aujourd’hui sur des risques pour l’essentiel exogènes. Je pense qu’il y a des enseignements à en tirer pour développer des mécanismes de même nature sur des problématiques de gestion publique proprement dites.
Troisième élément, les dispositifs d’alerte péniblement stabilisés par la loi du 9 décembre 2016. Là, c’est assez étonnant. J’avais suivi ces sujets-là dans d’autres fonctions, et on attendait de l’introduction du droit d’alerte dans la fonction publique une véritable explosion, une entrave absolue à l’action de l’administration. Je précise que je parle du droit d’alerte utilisé à bon escient. Très étonnement, on a finalement extrêmement peu d’alertes, en tout cas vu de ma sphère d’activité. Le comité de déontologie du ministère de l’Éducation nationale n’a été saisi, à la date d’aujourd’hui, d’aucune alerte au sens droit d’alerte. Cela mérite d’être regardé. Est-ce que les fonctionnaires, les agents publics ne connaissent pas ce qui peut donner lieu à l’exercice du droit d’alerte, c’est-à-dire les infractions délictuelles ou criminelles, ce qu’est une menace grave pour l’intérêt. Est-ce que c’est le fait qu’on a pris finalement trop de garanties, qu’on a trop impliqué la chaîne hiérarchique dans le dispositif ? Cela mérite en tout cas d’être regardé sur la base d’un premier bilan qui pouvait être fait.
En guise de conclusion, nous avons un certain nombre de mécanismes intéressants. Ils sont sans doute insuffisants pour prévenir la survenance de fautes de gestion. Pour progresser, je pense qu’il y a 3 sujets qu’il faudrait aborder assez clairement. Celui de la complexification de l’action administrative et du manque d’expertise de la plupart des administrations dans des domaines de plus en plus compliqués. L’exemple de l’ONP est particulièrement intéressant de ce point de vue. D’ailleurs, sur cette problématique des grands programmes informatiques, je me demande s’il ne faudrait pas réfléchir à la structuration interne à l’État d’une fonction d’expertise indépendante des ministères gestionnaires au même titre que ce qui a pu être mis en place dans d’autres domaines. Objectivement, un responsable public n’est pas de taille à résister, à se forger des opinions suffisamment étayées face à des experts, mais surtout des prestataires qui parfois, sont quand même dans des situations de monopole de fait, il faut bien le dire.
Deuxième élément de réflexion – c’est plus facile –, on se rend compte qu’autant on a progressé, je crois, au cours des dernières années, sur la formation, la sensibilisation des responsables publics aux règles déontologiques générales au sens du titre premier du statut général des fonctionnaires, autant la connaissance des risques encourus en tant que gestionnaire ou en tant qu’acheteur est encore très largement insuffisante. C’est d’autant plus important de s’y intéresser que ce sont des activités qui finalement ne sont pas – passez-moi l’expression – « nobles », et qu’elles reposent dans la plupart des cas non pas sur des cadres supérieurs issus des grandes écoles, mais souvent sur des agents d’exécution qui n’ont pas le recul nécessaire, la culture administrative nécessaire pour identifier seuls, si j’ose dire, le risque de faute ou d’infraction.
Dernier point, il faut bien constater la faible portée dissuasive du régime juridique de la responsabilité financière des ordonnateurs. De ce point de vue, la différence avec la crainte que l’on ressent par rapport au risque de mise en cause pénale est particulièrement frappante, alors que, me semble-t-il, le nombre de condamnations pénales de décideurs publics n’est pas très significativement supérieur aux mises en cause devant la CDBF. Le risque pénal est quelque chose qui marche formidablement bien quand on veut obliger des gestionnaires à s’acquitter d’un certain nombre de devoirs. Je me rappelle avoir manié ce risque pour obliger les ministères à remplir leurs obligations par exemple en matière de santé et de sécurité au travail des fonctionnaires. Là, on obtient des résultats extrêmement impressionnants par rapport à ce que l’on peut mettre en œuvre par la simple conviction. Comme la mise en cause semble de nature à satisfaire beaucoup mieux, au moins symboliquement en tout cas, nos concitoyens, sans doute parce qu’elle repose sur la culpabilité personnelle d’une personne physique, s’agissant des agents de l’État en tout cas. Je crois qu’un des enjeux des travaux d’aujourd’hui est peut-être de savoir si nous sommes ou non en mesure de concevoir, sans paralyser l’action administrative, un dispositif de sanction plus efficace et plus visible du mauvais usage des fonds publics pour résister à cette attraction assez irrésistible de la pénalisation.
Jean GAEREMYNCK
Je me propose maintenant de donner la parole à Madame Keller, qui a la qualité singulière à cette table d’être une élue, pas uniquement, parce qu’elle a commencé à travailler dans l’administration, elle connaît donc les arcanes de l’administration, mais elle est aussi très connue comme élue, elle a été maire de Strasbourg, sénatrice du Bas-Rhin et aujourd’hui députée européenne.
J’étais tenté de vous poser une question très large, très ouverte. Quels sont votre appréciation, votre point de vue, votre analyse du système de la responsabilité des fonctionnaires ? Mais est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelque chose de votre appréciation de la responsabilité des élus ?
 Fabienne KELLER
Fabienne KELLER
Si vous le voulez bien, je partagerai ce que j’ai vécu en collectivité essentiellement. C’est vrai que j’étais jeune fonctionnaire d’État, mais quand j’ai voulu suivre mon conjoint en province, j’ai basculé dans le privé puis dans la vie d’élue locale. On a pas mal parlé de responsabilité d’État et nationale. J’apporterai ma contribution plutôt sous l’angle de ce que j’ai vécu.
J’ai été élue d’abord départementale, régionale. J’étais maire de la ville de Strasbourg et présidente déléguée de son agglomération, puis parlementaire nationale et européenne. Permettez-moi de partager ce que j’ai sur le cœur.
Je vais essayer d’illustrer différentes natures de responsabilités. D’abord, la responsabilité de gestion. Les villes sont responsables des écoles, les départements, des collèges, les lycées sont à la charge des régions, on connaît bien cela. C’est une compétence matérielle sur les bâtiments, le fonctionnement. Le principal poste de dépense est le chauffage en termes de financements. Mais quand on est maire, on a conscience qu’on a la charge de l’accueil et de l’accompagnement des enfants, bien sûr en lien avec l’Éducation nationale, qui gère les personnels, qui a la mission pédagogique sur les projets des établissements, mais on peut aussi se dynamiser mutuellement. Quand l’école est sympa, agréable à vivre, quand on a des enseignants qui ont de bonnes conditions de travail, une salle des enseignants agréable, tout cela crée une ambiance propice à une gestion d’équipe dynamique.
À Strasbourg, nous avons une grande tradition, nous avons un service éducatif des musées, avec 28 personnes. Le service éducatif des musées propose, prête à l’emploi, une visite pédagogique avec des éducateurs qui accompagnent les enseignants. Cela permet aux enfants dont les familles n’auraient pas forcément l’idée d’y aller de fréquenter ces structures, et avec les accompagnateurs et parfois en reproduisant, les parents réaccompagnent les enfants, de s’ouvrir à un univers qui est extérieur. Là, c’est un croisement de la compétence de la collectivité gestionnaire et des pédagogues relevant plus de l’Éducation nationale. Une ville peut aider à ce que l’enseignant soit au cœur de la ville. J’étais sénatrice. Dans une petite commune, l’instituteur, l’enseignant est un personnage. Dans nos grandes villes, beaucoup moins. Comment leur donner une place, les faire respecter ? Je pense tout particulièrement à la question des directions d’école qui n’ont pas vraiment de statut, qui ne sont pas toujours reconnues, alors même qu’elles assurent une responsabilité très transversale vis-à-vis des familles, vis-à-vis du quartier. Par exemple, dans la question de la protection de l’enfance, les directions des écoles et les enseignants sont probablement la première source d’information des signaux faibles, mais extrêmement précieux. Donc, responsabilité de gestion, mais qui peut aller plus loin.
Deuxième type de responsabilité, la responsabilité transversale. Une ville, une agglomération a la chance d’avoir la compétence générale qui lui donne des leviers. Je voudrais l’illustrer sur le sujet de la rénovation urbaine. Un mot n’a pas été dit suffisamment jusque-là, me semble-t-il. Il y a eu la décentralisation qui, parfois, a mis plusieurs responsables sur un même territoire ou sur un même objet. La rénovation urbaine est un processus qui ne fonctionne bien que s’il est partagé. Bien sûr, il y a l’aspect physique au départ, rénover les logements, les espaces publics, créer des lieux agréables à vivre. Mais il y a aussi la sécurité parce que sans sécurité, on ne peut pas vivre dans un espace urbain. Là, on retrouve du régalien, la police. Il y a la question de l’État à travers ses différentes composantes. Et puis il y a question du lien entre les acteurs qui peut là aussi amener une dynamique, soit dans le rythme de la transformation du quartier, soit dans la gestion, la simultanéité, donnant d’ailleurs de la crédibilité à la rénovation urbaine, ce qui fait que les gens y croient, les acteurs y croient, et il y a une dynamique partagée. Comme beaucoup de personnes qui ont eu des responsabilités dans les grandes villes, je porte la conviction que les quartiers difficiles sont déterminants pour l’avenir de la société française. C’est là que de nombreuses tensions apparaissent ou sont plus fortes qu’ailleurs. Se mettre tous ensemble pour cet objectif est donc particulièrement important. Comment évalue-t-on la responsabilité de l’un ou de l’autre ? C’est compliqué parce que c’est partagé.
Je pourrais vous donner le même exemple de responsabilité transversale pour les projets gares, que j’affectionne beaucoup. Dans les gares, il y a beaucoup d’acteurs, SNCF Réseau, la ville, l’agglomération, la région, le département, l’office du tourisme, les commerçants, il y a beaucoup de monde. Pour réussir une belle gare, un beau centre-ville, il faut que tout le monde travaille ensemble. J’ai envie de dire que là, l’élu local a une responsabilité de gouvernance, de pilotage, de manager en fait.
Les élus ont aussi une responsabilité financière. La finance qui est formellement présentable n’est pas toujours la plus efficace sur le fond. Je voudrais vous donner un exemple. Place Kléber, au cœur de Strasbourg, nous avons un bâtiment historique qui s’appelle l’Aubette. C’est un bâtiment de type militaire. Je suis en charge à la ville de Strasbourg. À ce moment-là, nous avons beaucoup de chantiers en cours, une grande bibliothèque, un Zénith, un gros chantier de tramway, beaucoup de rénovation urbaine. Les services techniques sont donc full, ils ont du mal à accepter des projets en plus. Cette Aubette est tellement centrale qu’elle est naturellement occupée par des commerces au rez-de-chaussée. Les commerces, c’est des devantures qui changent, c’est de la vie.
Nous prenons la décision de faire un PPP [partenariat public-privé, ndlr], un vrai PPP, c’est-à-dire un projet avec de vraies recettes privées. Le bâtiment est en très mauvais état, c’est d’ailleurs une pissotière à l’arrière ; les étages ne sont plus utilisés depuis longtemps parce qu’ils ne sont pas du tout aux normes. Nous faisons un appel à projets avec comme objectif, la mise en sécurité de l’ensemble. C’est un double bâtiment, historique, classé, toutes les contraintes techniques. Nous pouvons exploiter le rez-de-chaussée en commerces et garder les étages publics. Dans le contrat, nous mettons la responsabilité de l’exploitation à la charge de l’investisseur gestionnaire. Concours avec architectes et investisseurs. L’investissement évalué par celui qui a été retenu dans cet appel à projets est de 30 millions. En fait, cela en coûtera 40, mais c’est son problème, ce n’est plus celui de la ville. Donc, report du risque sur un gestionnaire avisé. C’est un opérateur de centres commerciaux qui le prend en main ; il a donc l’habitude de gérer des commerces et il sait optimiser. La ville n’a plus de frais de gestion pour soixante-dix ans. Il y a un centre pompier 24/24, ce qui coûte une fortune : cela ne coûte plus rien en frais de fonctionnement à la ville.
Beau montage. Incompréhension totale de la population parce que la contrepartie était un loyer très bas pour le bâtiment, parce qu’il fallait que l’opérateur finance l’investissement par les loyers à venir. Un montage qui, franchement, m’avait semblé sain, équilibré et efficace, mais qui n’a pas du tout été compris par la population.
Notre responsabilité est d’expliquer, d’écouter, d’amender aussi, parce que la population aujourd’hui veut comprendre. Elle est informée par les réseaux sociaux. Elle sait tout. Encore plus dès qu’on parle d’école, dès qu’on parle de circulation. Dès qu’on parle de vie dans la ville, tout le monde sait, tout le monde a son point de vue, et « il est légitime puisque c’est le mien », mais comment discerner l’intérêt général et l’intérêt ponctuel ? Je voudrais rebondir sur votre expression, Madame Falque-Pierrotin, le gestionnaire ne doit pas être seul, il doit être en échange, en discussion, mais au moment de la décision, quelque part, il est quand même seul.
Autre cas de responsabilité, la responsabilité pour l’avenir. À Strasbourg, nous avons eu un grand maire qui s’appelait Pierre Pflimlin, qui a réservé d’immenses terrains à l’entrée du quartier qui s’appelle la Robertsau pour accueillir des institutions européennes. Quand on relit la presse de l’époque, cela semblait déraisonnable. Aujourd’hui, la quasi-totalité de ces terrains est bâtie. Il les a achetés peu cher et il a classé au PLU de vastes terrains pour l’avenir. Je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui, on ait les mêmes méthodologies, c’est-à-dire d’anticiper pour dans longtemps.
De la même manière, après la guerre, beaucoup de reconstructions se sont faites par ces baux emphytéotiques avec retour du bien. Parfois, ce n’était pas parfait, on avait oublié de mettre une clause sur l’état du bâtiment, mais cela fait que reviennent dans le patrimoine collectif des biens au bout de plusieurs décennies. Est-ce que nous avons cette gestion ? C’est comme les grands-pères qui plantaient des arbres pour leurs petits-enfants, pour qu’il y ait des sortes de clauses de retour à bonne fortune, une gestion du très long terme.
Il y a aussi la question de la responsabilité de management, donner des perspectives à nos fonctionnaires, donner du sens à la mission qui est la leur, les motiver, respecter chacun. Madame la secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale, c’est important, mais je voudrais témoigner que notamment à travers l’organisation départementale, les inspections d’académie, il y a vrai travail là-dessus, il y a une vraie qualité d’accompagnement, de reconnaissance et de pilotage en proximité parce qu’il faut reconnaître les mérites.
Enfin, la dernière responsabilité que je voudrais évoquer est la responsabilité judiciaire, qui peut être parfois financière, mais qui peut être aussi pénale. Je voudrais partager ici le fait que j’ai connu un grave accident au début de mon mandat. Les procédures judiciaires sont des mécanismes lents, très lourds. Je dois dire que je n’y connaissais pas grand-chose, que je l’ai découvert. C’est très difficile. Il y a eu des morts et des blessés. C’est la question de l’empathie vis-à-vis des victimes. Je me suis même demandé à un moment donné s’il fallait que la ville se défende, s’il ne valait pas mieux laisser faire la justice. C’était un accident très grave, survenu le 6 juillet 2001, le drame du Pourtalès**. Il a fallu néanmoins défendre la ville parce que des agents, le directeur du service de la culture, le directeur du service des espaces verts étaient témoins assistés. Mais que dire en tant qu’élue face aux familles dont la vie a basculé ? Bref, la responsabilité pénale et judiciaire est quelque chose qui est lourd et qui ne vous quitte plus. Nous avons été élus pour rendre les gens heureux, c’est en tout cas ce que l’on a envie de faire pour travailler, se projeter dans l’avenir, mais la vie est ainsi faite que les élus locaux ont cette responsabilité finale, et j’ai envie de dire avec les chefs d’établissement scolaire, avec un certain nombre de responsables de sites publics, comme les responsables d’entreprises, de sites industriels. Ce sont des îlots de responsabilités. C’est bien qu’il y ait cette responsabilité, mais c’est parfois lourd aussi.
Jean GAEREMYNCK
Je me tourne maintenant vers Monsieur Thomas Cazenave, qui est actuellement délégué interministériel à la transformation publique, mais qui a déjà eu le temps d’avoir une expérience administrative profonde dans l’administration de Pôle emploi et au ministère de l’Économie et des Finances.
J’ai envie de vous dire : évidemment, l’objet de cette table ronde était de dresser l’état des lieux. Cela nous a amenés à porter l’accent sur des formes de difficultés, il faut bien le dire, ou d’impasses ou de choses qui ont été ressenties douloureusement, des échecs complets ou des demi-échecs. Vous qui êtes un peu plus jeune que moi en particulier, vous représentez l’avenir. En plus, vous êtes sur la transformation publique. Cela tombe très bien. Nous nous demandons tous un peu comment faire et comment vous prenez la question. Quelles sont les conditions à remplir, quel est votre point de départ pour réfléchir à cette transformation dans le domaine de la responsabilité ?
 Thomas CAZENAVE
Thomas CAZENAVE
Vaste question ! Après deux ans dans mes responsabilités comme délégué interministériel à la transformation publique, mais aussi au regard de mon expérience en opérateur, en administration centrale, en cabinet ministériel, je crois qu’on touche là la question principale qui nuit et qui est une forme d’entrave à l’action publique. Vous le disiez, Isabelle Falque-Pierrotin, je trouve qu’il y a aujourd’hui un immense gâchis, c’est-à-dire qu’on se rend compte que l’on est à la fois extrêmement attendus et que l’on déçoit une partie de nos citoyens sur l’efficacité de l’action publique, une défiance s’est installée, mais je dois aussi le dire, ce sentiment est souvent partagé par les agents publics eux-mêmes. Il n’est pas unilatéral, ce sentiment de gâchis, d’impossibilité, comme si, notamment au sein de l’État, on était un peu Gulliver empêtré, qu’on n’arrivait pas à avancer assez vite, qu’on n’arrivait pas à produire de résultats, qu’on n’arrivait pas à répondre aux attentes. Je crois que ce sentiment-là, partagé de part et d’autre, renvoie à une question fondamentale qui est celle de notre fonctionnement interne. Notre fonctionnement interne, qui n’a pas été profondément revu depuis plusieurs décennies et qui renvoie à une lente dilution des responsabilités, qui me semble être au cœur – j’essaierai de l’expliquer en quelques minutes – de la feuille de route du Premier ministre sur la transformation de l’action publique telle qu’on l’a engagée depuis deux ans.
On a beaucoup évoqué la question de la responsabilité, la responsabilité financière, mais je pense que c’est quand même un sujet qui vient après. Je crois sincèrement que les citoyens, certes, sont très regardants sur la probité, sur la responsabilité des gestionnaires publics, mais je vais vous donner mon sentiment, ils veulent surtout des résultats, ils veulent une action publique plus efficace. Je pense que le principal risque que nous courons collectivement n’est pas le risque de l’irresponsabilité, c’est plutôt le risque de la paralysie et le fait que l’on n’avance plus assez vite. C’est donc un peu mon sentiment. On a moins de risque de conformité que de risque de non-exécution, si je devais présenter les choses de cette manière.
Raoul Briet le rappelait, la responsabilité financière, c’est aval. D’abord, dans quel cadre de responsabilité se situe-t-on ? Je dois dire que quand j’essaie de le décrire, c’est assez compliqué. D’abord, qui est responsable de manière générale, d’un projet, d’une réforme, petite ou grande ? Est-ce que c’est le ministre ? Est-ce que c’est le directeur d’administration centrale ? Si oui, comment se fait le partage de responsabilités ? À l’intérieur de l’administration, qui est le responsable ? On a tenté de changer la manière dont on travaille, sur le sujet de nos grandes réformes prioritaires en identifiant par exemple des chefs de projet, qui se lèvent le matin et se couchent le soir en disant : « C’est ma responsabilité que d’amener ce projet ». Je crois que derrière ce qu’évoquait Raoul Briet de l’ONP, c’est très difficile de savoir qui est responsable, parce que les responsabilités sont très diluées. Qui est le chef, qui est en charge d’un projet de A à Z ? Notre organisation administrative n’est pas bâtie comme cela. Elle se heurte donc à ce principe de responsabilité. C’est vrai que l’on n’a pas choisi des modèles qui existent en Europe du Nord, les modèles de l’agence, où on a une feuille de route politique et ensuite, des directions, des agences, des opérateurs qui sont missionnés pendant plusieurs années pour exécuter. On est donc toujours dans une forme de porosité des responsabilités entre la responsabilité politique, administrative, elle-même très diluée.
Deuxième élément pour la responsabilité, le risque de paralysie : quelles sont les marges de manœuvre qu’on laisse aux agents publics ? En fait, notre organisation est extrêmement centralisée. On a conduit un baromètre auprès des 1 500 cadres supérieurs de l’État, ceux qui conduisent les réformes, ceux qui les portent, préfets, directeurs départementaux, directeurs régionaux, chefs de service, sous-directeurs. Ils disent qu’un tiers seulement d’entre eux pense que les décisions sont prises au bon niveau. Un tiers seulement pense qu’ils ont les responsabilités et les marges de manœuvre nécessaires pour adapter nos politiques publiques, mettre en œuvre nos services publics. En fait, on est dans un sujet extrêmement centralisé. Vous l’évoquiez en introduction, la production normative enserre complètement le travail des agents publics et des managers publics. Ils reçoivent en permanence des circulaires extrêmement nourries qui leur disent exactement ce qu’ils doivent faire. Quand ils sont dans des territoires – vous évoquiez un exemple à Strasbourg –, quelle est la réalité de leur marge de manœuvre pour adapter les services publics, et donc, pour retrouver la capacité d’action et l’efficacité publiques ? Ils ne sont pas responsables. Ils disent : « Je vais en référer en administration centrale » et cela remonte. On a donc en fait une forme de culture de l’irresponsabilité à tous les étages.
Enfin, dernier élément, et c’est pour cela que l’on n’a pas assez de principes de responsabilité et d’autonomie, c’est le principe de défiance. On a bâti un système de contrôle et de surcontrôle pour être sûr que les 2 % potentiels qui pourraient contourner la règle soient pris. On impose à 98 % d’entre eux des règles extrêmement strictes. On est en fait dans une situation de surcontrôle. Avant d’exercer les responsabilités qui sont les miennes, j’ai été pendant cinq ans directeur général adjoint de Pôle emploi. J’avais en permanence des missions, des contrôles, qui s’exerçaient. On a l’impression d’être surcontrôlés. Est-ce que ce surcontrôle est efficace ? Je n’en sais rien. Mais la réalité est qu’un principe de défiance s’applique.
Je vais essayer de vous donner un exemple très concret. On a essayé de déployer le droit à l’erreur. On met en œuvre le droit à l’erreur, qui était une annonce dans le programme présidentiel et qui fait l’objet de la loi Essoc votée en août 2018. Quelques mois après le vote de la loi, on s’est rendu compte qu’on avait des difficultés d’application. C’est normal, parce que les agents publics sont en injonction contradictoire. On leur dit « reconnaissez le droit à l’erreur, soyez donc une administration bienveillante, qui accompagne », mais en interne, ils n’ont aucun signe de ce droit à l’erreur. C’est donc forcément compliqué pour eux de reconnaître, vis-à-vis des usagers et des citoyens, un droit à l’erreur qu’on ne leur reconnaît pas en interne.
Tout cela pour dire que notre conviction, c’est que l’enjeu fondamental sur le champ de la réforme de l’État et de la transformation publique, c’est notre fonctionnement interne, qu’il faut revoir. Je pense que c’est la mère de toutes nos réformes, probablement avec des difficultés que l’on rencontre dans la mise en œuvre concrète de nos réformes. D’ailleurs, le président de la République, à l’audience solennelle de la Cour des comptes en 2018, rappelait à quel point il fallait qu’on retrouve le sens de la responsabilité, le sens de la déconcentration, le sens de l’autonomie des agents publics au risque d’offrir le triomphe des prudents, je crois que c’est le terme qu’il a employé ici même. Vous avez tout à fait raison, le volontarisme ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire aux agents publics, aux directeurs d’administration centrale « allez-y » si on n’a pas changé un peu les règles du jeu. Les éléments sur lesquels nous avons travaillé depuis deux ans, Raoul Briet le rappelait, avant que ce soient des textes, avant que ce soit le PLF ou la Lolf, c’est un problème de pratiques et de culture.
Est-ce qu’on est orienté résultats ? Non. Nous avons donc remis l’orientation résultats au cœur de toutes nos politiques publiques. Je vous donne deux exemples. Nous avons progressivement imposé à tous les services publics de mesurer et publier leurs résultats à la maille locale. Que les citoyens connaissent le résultat de leur caisse d’allocations familiales, de leur commissariat, de leurs collèges, de leurs lycées me semble très important. Le sens de la responsabilité, c’est d’abord cela quand même. C’est le sens de l’efficacité de l’action publique.
Deuxième élément, on a changé le dispositif de suivi de l’exécution des réformes. Cela a fait l’objet d’une circulaire récente du Premier ministre aux ministres et aux préfets de région, en disant que derrière la soixantaine de réformes prioritaires, un, nous avons un chef de projet, donc une personne vraiment en charge – ce sera quand même beaucoup plus simple de savoir si une réforme marche ou ne marche pas si on sait qui est en charge de la réforme – et deux, quels sont les impacts et les résultats attendus. Pourquoi fait-on tout cela ? Comment identifiera-t-on qu’on est en train de réussir ou d’échouer ?
Troisième élément, le droit à l’erreur et le droit à l’erreur interne.
Deuxième élément sur lequel nous avons travaillé depuis deux ans, parce que c’est un sujet d’organisation : comment nos administrations centrales fonctionnent. Nous sommes en train de revoir tous les arrêtés d’organisation de toute l’administration française, où nous avons supprimé toute la maille inférieure au sous-directeur. Il faut laisser beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de liberté d’organisation et revenir sur des organisations qui sont trop hiérarchiques et qui empêchent le principe de responsabilité.
Nous avons lancé une grande consultation des agents publics. Ils sont 135 000 à avoir répondu, 1,6 million de votes, 29 000 propositions. Dans les principales attentes, ils disent que nos organisations sont trop complexes, trop hiérarchiques, qu’il y a trop de niveaux, trop de chefs. Il faut entendre cela et il faut changer la manière dont on manage, la manière dont nous conduisons nos réformes. C’est le sens de la circulaire du Premier ministre et de la réforme de nos administrations centrales.
Troisième élément, il faut changer nos façons de travailler, vous l’avez évoqué. Le principe de responsabilisation passe d’abord par de la déconcentration. On est un peu trop embolisés à la tête. J’avais eu l’occasion de l’évoquer dans un autre cadre, les administrations centrales sont probablement trop nombreuses aujourd’hui par rapport aux forces que nous avons sur le terrain, à nos services sur le territoire. Il faut déconcentrer. Le Premier ministre a décidé que 95 % des décisions individuelles qui sont aujourd’hui prises en administrations centrales devaient être prises en administrations déconcentrées.
Nous avons allégé les contrôles. La direction du budget a fait un travail remarquable d’allègement de tout un tas de contrôles tatillons inutiles qui empêchent d’avancer. Ce travail n’est pas terminé.
Enfin, nous avons essayé de renouer avec un esprit de la contractualisation, c’est-à-dire que les managers publics ont besoin d’avoir un peu de visibilité sur leurs moyens, sur leurs objectifs pour pouvoir s’engager dans des réformes compliquées et donc, faire prévaloir le principe de responsabilisation.
Bref, tout cela pour dire que je pense qu’avant de parler de responsabilisation financière, voire de pénalisation de l’action publique pour les managers publics, il faut avoir reconstruit un vrai système, une vraie organisation qui les remette déjà en situation de responsabilité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Je considère donc que cette question est un peu aval et que cette responsabilisation financière n’existera pas si on n’a pas déjà créé un système beaucoup plus responsabilisant. Il est indispensable pour que l’on avance plus vite et que l’on ait des résultats plus rapidement sur l’ensemble des champs de politique publique sur lesquels nous conduisons des réformes importantes.
Jean GAEREMYNCK
Je propose de vous relayer des questions du public, qui sont très nombreuses. Je pointe deux questions, que je trouve vraiment intéressantes, sur lesquelles nous aurons besoin d’approfondir l’analyse. Le numérique ne remet-il pas en cause le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et, d’une manière générale, au-delà de cela, l’effet de ces nouvelles technologies, notamment le numérique, sur les modes d’organisation, et très concrètement, la responsabilité ? Autre question qui interroge ce qui se passe aujourd’hui dans la société et les répercussions sur le système tout entier : les réseaux sociaux. Ne mettent-ils pas une nouvelle forme de pression sur les gestionnaires publics ? Ne faut-il pas prendre cela en considération très fortement pour l’évolution du système ?
Nous sommes partis du grand débat national, parce que c’était vraiment très intéressant, que c’était un sondage grandeur nature sur les sentiments de la population. Il y a un côté négatif, les critiques, l’insatisfaction, les frustrations, etc. Mais une question soulève une interrogation positive : est-ce que cela fait émerger aussi des éléments d’appréciation positive auxquels on puisse tout de même se raccrocher ?
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Peut-être une double réaction. Est-ce que des éléments positifs ont été exprimés dans le grand débat ? Par construction, le grand débat est l’expression souvent de critiques, il y a donc évidemment un biais en faveur de la critique, mais tout de même, il y a des éléments positifs, notamment sur les valeurs du service public. Je crois que les valeurs du service public n’ont pas été remises en cause par nos concitoyens, au contraire, nos concitoyens sont très demandeurs du renforcement de ces valeurs. Ce qu’ils critiquent dans la gestion publique, c’est dans le fond ce que Thomas Cazenave a dit à l’instant, c’est-à-dire le fait que cette gestion publique est inefficiente, elle n’est pas suffisamment efficace par rapport à la manière dont les décisions publiques sont prises aujourd’hui. Ce qui fait le cœur de la légitimité de l’action publique, je ne crois pas qu’il soit remis en cause.
Fabienne KELLER
Sur la question des réseaux sociaux, c’est une réalité. On peut le regretter, mais c’est présent. Un sujet un peu particulier est que les réseaux sociaux ont un effet d’amplificateur sur des idées radicales, voire dangereuses. C’est un sujet que je traite au niveau européen. Par exemple, le retrait des contenus terroristes sur les réseaux sociaux, c’est un vrai sujet. La violence exacerbée d’un tout petit nombre de gens, qui est présente sur la Toile. Mais après, il y a le réseau social plus positif qui est : « Je donne un avis sur un projet public, sur un événement qui vient de m’arriver et j’exprime mon mécontentement de manière assez directe ». Cela, c’est un levier assez positif, parce que c’est une manière de raccourcir la relation. Cela peut être assez constructif et c’est plus largement, pour moi, un révélateur d’une exigence de nos concitoyens à comprendre, chacun avec ses clés, avec son regard, avec les éléments d’information dont il dispose et ce qui est important pour lui. Évidemment, c’est très différent suivant les personnes et je pense que c’est apparu au grand débat. Mais je trouve qu’au grand débat, il est aussi apparu des choses très positives, par exemple, alors que l’origine était la révolte contre la taxe carbone, on n’a plus du tout observé le débat des anti et pro-développement durable. Même les « gilets jaunes » eux-mêmes avaient des paroles apaisées sur la gestion du long terme et le besoin de faire quelque chose, mais pas tout de suite et pas comme cela, parce que cela les pénalisait. Mais ils n’ont pas remis en cause l’objectif partagé de développement durable.
Sur un autre sujet qui m’est cher, vous me pardonnerez, est apparu dans le débat national le sujet des pensions alimentaires. Cela m’a beaucoup touchée, les femmes sont apparues au début du grand débat, plutôt en janvier. Rappelez-vous, il y avait des réunions spéciales femmes le dimanche matin. Puis elles ont disparu parce qu’une femme seule a beaucoup de choses à gérer et il y a une sorte de pragmatisme un peu féminin. C’est donc une préoccupation sociale majeure. Pour moi, plutôt en élue locale, c’est un sujet de tension familiale et sociale majeure. Régler proprement le paiement des pensions alimentaires est une source d’économies budgétaires : moins de travailleurs sociaux qui accueillent les personnes en difficultés, moins de fonds d’urgence de la ville, moins d’aide complémentaire de la CAF quand la pension n’est pas payée, moins de juges qui s’occupent de tout cela, et moins de tensions. La pension alimentaire est un levier de tensions familiales. Je plaide donc pour que le système canadien soit directement appliqué, c’est-à-dire paiement de la pension par un organisme d’État, je plaide pour la DGFIP, et recouvrement par l’État pour se dégager de ces tensions d’autant que les compositions familiales ont beaucoup tendance à se complexifier le temps passant.
Je parle de cet exemple, car je trouve qu’il a bien montré que le débat public a révélé de vrais sujets, très profondément ancrés dans la société, et presque un appel au bel État, à l’État protecteur de la famille monoparentale en situation de fragilité.
Je pense donc que les réseaux sociaux sont à la fois un danger et un levier, à charge pour nous de les prendre en compte et de les façonner.
Thomas CAZENAVE
Je trouve que justement, les réseaux sociaux invitent à transformer notre organisation. Quand, sur les réseaux sociaux, apparaît par exemple un élément sur le mauvais traitement d’un dossier, sur un nid-de-poule non réparé, cela exige de l’administration qu’elle soit très réactive, qu’un agent public puisse prendre la responsabilité de répondre sur les réseaux sociaux, voire d’enclencher une action. Mais pour cela, vous ne pouvez pas avoir une organisation très hiérarchique et très verticale parce qu’elle se heurte au temps des réseaux sociaux. Elle nous invite aussi par la pression de l’externe à revoir nos organisations.
Par ailleurs, pour canaliser un peu l’expression des usagers du service public sur les réseaux sociaux, nous avons ouvert sur le site Service-public.fr ce que l’on appelle Vox Usagers. Cela permet aux citoyens d’expliquer leur expérience avec le service public, bonne ou mauvaise, mais bonne aussi. Il y a des belles histoires et parfois, cela marche très bien, il faut le dire et le mettre en avant. La brigade numérique de la gendarmerie, la CAF, Pôle emploi… Les citoyens relatent leur expérience et l’administration est obligée de répondre. Je pense donc qu’on peut créer des espaces plus régulés que les seuls avis Google ou avis Facebook, pour que ce soit de l’information utile pour les services publics et non pas juste un déversoir parfois d’injures et de mécontentements.
Raoul BRIET
Sur le numérique, je pense que la question est pertinente. Je ne sais si notre modèle remonte au Code de Hammurabi, mais le modèle canonique était celui d’un trésorier-payeur général qui, dans son ressort territorial, avait et pouvait assumer la responsabilité de l’ensemble des opérations de dépenses publiques et de recettes publiques. Le système actuel a très profondément évolué par rapport à ce modèle canonique, d’abord parce que les directions départementales des finances publiques se sont maintenant spécialisées. Comme contribuable, vous voyez que le comptable responsable du recouvrement de ma taxe d’habitation est dans le Grand Est. Bref, tout cela est déterritorialisé. Par ailleurs, fondamentalement, les comptables responsables en titre se trouvent aujourd’hui intégrés dans des processus beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes, beaucoup plus amont, dont ils ne maîtrisent pas les tenants et aboutissants. Je pense que la question qui nous est posée, par-delà les questions de principe, c’est d’adapter ou de refonder les régimes de responsabilité pour tenir compte de ce que sont les conditions effectives d’exercice par les intéressés de leur mission de veiller à la régularité des dépenses publiques. Cela oblige donc à repenser à tout le moins les modalités.
Jean GAEREMYNCK
Comme Thomas Cazenave a travaillé à Pôle emploi, je voudrais poser cette question. J’ai été délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle. J’étais quand même frappé de la contradiction qui me paraissait évidente entre le fait que la formation professionnelle soit de la compétence des régions, notamment la formation professionnelle des chômeurs, et que les moyens en matière de formation professionnelle étaient à Pôle emploi. À un moment donné, nous étions invités à un début de période politique à phosphorer, nous avions préconisé un schéma quasiment de régionalisation de Pôle emploi, c’est-à-dire que les moyens soient, pas forcément éclatés de l’établissement public, mais l’articuler complètement avec la gouvernance régionale. Nous pensions que tant que l’on n’avait pas fait quelque chose comme cela, on manquait une étape d’efficacité. Les conditions d’efficacité optimales n’étaient pas du tout réunies. Pardon, j’évoque cela « brut de décoffrage », mais c’est un exemple de conception générale du système qui peut aider à avoir plus d’efficacité, plus de résultats, et une meilleure responsabilité des gestionnaires du système.
Thomas CAZENAVE
Cela renvoie à un sujet autour de la responsabilisation. L’éclatement de notre politique publique, parfois entre plusieurs acteurs, nuit considérablement à son efficacité et la formation des demandeurs d’emploi en fait partie, qui est aujourd’hui coupée entre la responsabilité des conseils régionaux et un opérateur national. Vous pouvez répondre de deux manières différentes à cette situation. Il y a l’option que vous décrivez, de régionalisation de Pôle emploi, et vous pouvez regarder des modèles comme celui de l’Allemagne par exemple, une organisation fédérale, des Länder très forts, et pour autant, qui ont gardé une agence nationale. Je suis d’accord que l’entre-deux n’est pas la meilleure des solutions, mais je vous invite à regarder les exemples étrangers qui ne sont jamais allés jusque-là, y compris dans les organisations institutionnelles les plus décentralisées.
Fabienne KELLER
Je voudrais rebondir. On peut tirer beaucoup d’enseignements très intéressants d’expériences étrangères. Nous travaillons beaucoup avec les Arbeitsagentur, parce qu’en Allemagne, ils recrutent beaucoup et régionalement, Pôle emploi travaille avec eux. Ils ont la capacité de liquider le dossier d’indemnités, de s’en occuper, de le monter et de mobiliser des fonds de formation. C’est plus simple parce qu’ils ont beaucoup moins de chômeurs que nous, mais cela doit nous interpeller sur notre gestion en silos. J’ai envie de dire, cela doit interpeller aussi sur les outils que nous utilisons. Je tiens encore un peu des permanences. Pour des raisons d’efficacité, nous avons beaucoup introduit le numérique dans le suivi des chômeurs. Ils disent qu’ils ne font que des clics alors que ma perception est que le sujet du chômage est très largement psychosocial, c’est la question du courage pour aller en entretien, pour se présenter. Tout ce qui est collectif et qui est développé par Pôle emploi est très intéressant, les gens peuvent bénéficier d’un coaching, d’un accompagnement, d’un soutien, mais la rationalisation des actes de gestion peut induire une distanciation par rapport à une relation humaine qui me semble être très importante pour les demandeurs d’emploi. Au bout de trois mois, ils sont en mauvais état, et au bout de six mois, ils ne sont plus, en moyenne, en capacité de tenir un entretien tellement ils sont affectés. Il y a donc un moment où les outils sont aussi importants dans l’accompagnement. Évidemment, en France, nous avons encore un taux de chômage élevé. Il y a une question de masse. Je voulais partager cela et plaider pour les actions collectives et pas forcément individuelles qui permettent, de manière formelle et informelle, d’assurer cette dynamique.
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Je veux juste partager la question, qui a été posée : quel est notre modèle qui serait le plus pertinent de l’organisation administrative optimum pour les gestionnaires publics ? Ce que nous apprend le numérique, c’est que justement, il n’y a pas un modèle, et qu’en réalité, il faut être extrêmement pragmatique et, dans certains cas, conjuguer la plus forte distribution des responsabilités au plus proche du terrain, et dans d’autres cas, au contraire, avoir une logique d’agence, une logique de centralisation, etc. Je crois qu’il faut arrêter d’invoquer cette idée de modèle unique de l’organisation administrative ou de la gestion publique. Il n’y en a pas. Il faut jouer le meilleur instrument, la meilleure organisation selon les questions qui sont posées.
Raoul BRIET
Un dernier mot, pour créer un écosystème responsabilisant – on n’a pas encore beaucoup parlé de ce sujet – il faut définir précisément le « qui fait quoi » entre l’État, les collectivités locales et au sein des collectivités locales. Or la mode est aux politiques partagées. Plus les politiques sont partagées, moins les responsables sont identifiables.
* Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté d’environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique.
** La chute d’un arbre, provoquée par une tempête, lors d’un concert en plein air en 2001, avait fait 13 morts et une centaine de blessés dans le parc de Pourtalès, à Strasbourg.
Voir la table ronde en intégralité
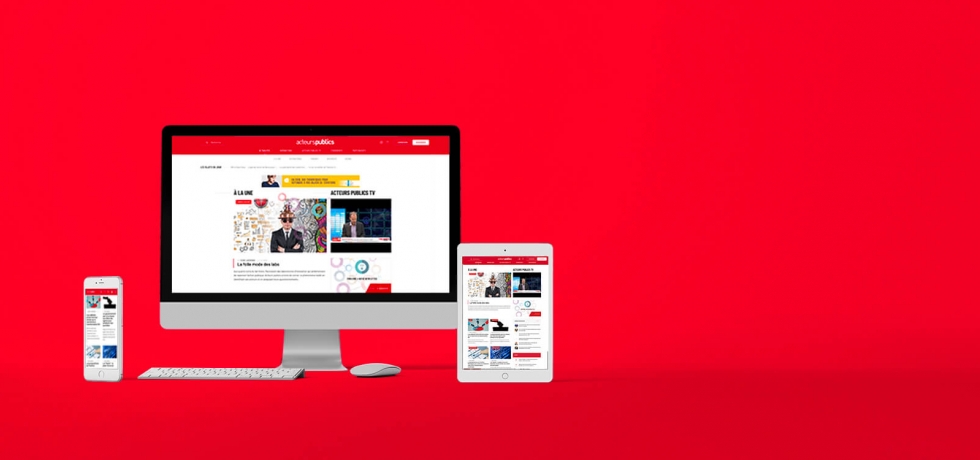
ÉTAT | COLLECTIVITÉS | HÔPITAL
L’essentiel du management public
FORMULE INTÉGRALE
1200€ / an







